MAROC HOTELS?

MAROC HOTELS?

chambre randonnee meknes tinghir
Le temps où les grandes caravanes venues du Niger ou de Tombouctou convergeaient à travers le Sahara vers les cols de l’Atlas est bien révolu. De même, les immenses troupeaux de dromadaires qui, il y a quelques décennies encore, transhumaient de pâturage en pâturage au fil des saisons ne sont plus qu’un souvenir. On en connaît bien les raisons : fermeture des frontières, évidente supériorité pratique du camion et du 4x4 sur les animaux de bât, attraction des villes, de leur confort, de leurs écoles et de leurs hôpitaux… Paradoxe : même si toute vie ne l’a pas abandonné, le désert semble n’avoir jamais été aussi désert qu’aujourd’hui… Combien de temps faudra-t-il encore pour que disparaissent les dernières khaïmas en poil de chèvre, pour que les derniers nomades abandonnent sur le seuil de maisons en dur leurs semelles de vent ? Le novice des pistes ne cesse pourtant de s’en étonner : le soir, au bivouac, alors qu’il commence à se croire le dernier être vivant sur la terre, il voit parfois surgir de la nuit des hommes silencieux qui le saluent d’un geste et d’un sourire, s’accroupissent en cercle autour du feu, bavardent un moment à voix basse, puis se lèvent et disparaissent comme happés par le vide. Ainsi est le pays des grandes solitudes, encore hanté par les spectres de ses derniers habitants… Une civilisation est en passe de disparaître sans bruit sous nos yeux. Elle ne laissera sans doute nulle trace dans le sable. À nous de la garder précieusement dans nos mémoires… Sa saveur, fine et très goûteuse, en a fait l’aristocrate des fruits secs. Au Maroc, l’amande a toujours été, même chez les plus pauvres, l’offrande par laquelle on honore ses hôtes, la compagne attendue de toutes les fêtes, un signe incontestable de raffinement... es plus anciennes cultures d’amandiers sont attestées en Grèce dès 4000 ans avant JC, aux côtés de vergers produisant des poires, des olives et des figues. Les Hébreux les introduisirent en Égypte, les Romains rapportèrent en Europe occidentale la « noix grecque » avant que les Arabes ne la propagent sur tout le pourtour méditerranéen, au fur et à mesure de leurs conquêtes. Au Maroc, s’il n’est pas aisé de situer l’époque exacte à laquelle l’amandier a été introduit, il semble que, résistant remarquablement à la sécheresse et très peu exigeant, il se soit implanté spontanément dans les vallées et sur les plateaux de l’Atlas. On hésite à employer le mot, tant il est galvaudé. Mais comment ne pas parler de miracle quand on pénètre dans une oasis ? Si « le désert, c’est Dieu sans les hommes », l’oasis, c’est l’œuvre des hommes seuls, une création née de leur volonté acharnée de survivre, de leur invraisemblable capacité à faire jaillir la vie là où ne régnaient que la pierre et le sable. L’oasis, c’est le murmure des seguias, l’ombre dense des palmiers, le parfum des citronniers, de la luzerne fraîchement coupée et des terres labourées. Un miracle, en effet, mais un miracle qui doit tout à la sueur du fellah… On ne visite pas une oasis, on la goûte, on la hume, on y guette au lever du soleil les premiers chants d’oiseaux et les brumes rases qui frôlent les carrés de luzerne, on y attend la paix du soleil couchant quand hommes et bêtes remontent fourbus au village. Menacées par l’exode des paysans vers les villes, par le manque d’entretien des khettaras et des seguias, beaucoup sont inexorablement reprises par le désert. Il en reste heureusement d’admirables. À parcourir celles de Tineghir, de Fint, de Tagounit ou de la vallée du Draâ, on comprend comment des tribus du désert ont pu inventer, il y a des millénaires, le mythe du Paradis terrestre.
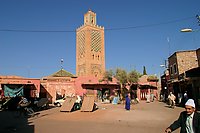
| Hôtels au Maroc |